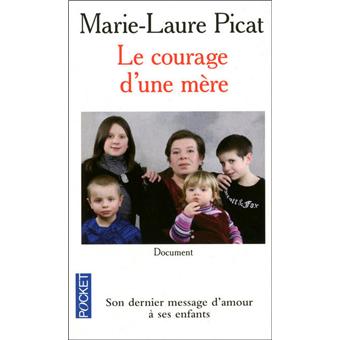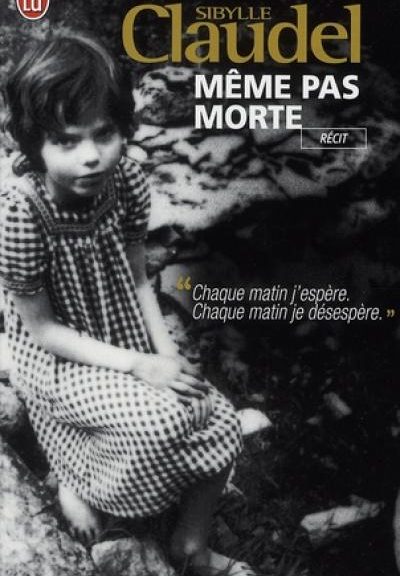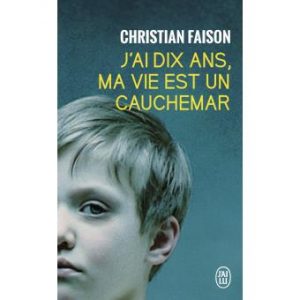Interview d’Halimata Fofana
Aujourd’hui, je vous propose de découvrir le parcours d’une jeune fille qui perdra son insouciance à l’âge de cinq ans, dans l’atrocité de l’excision.
Aujourd’hui, je vous invite à découvrir le parcours d’une adolescente qui sera contrainte au silence de sa souffrance.
Aujourd’hui, je vous invite à découvrir une femme qui a décidé de se relever, de parler, de vivre.
Halimata Fofana est l’auteur du livre « Mariama, l’écorchée vive ».
Vous pouvez commander son livre sur http://www.karthala.com/hors-collection/2981-mariama-lecorchee-vive.html ou sur Fnac.com : Mariama, l’écorchée vive (ceci est un lien d’affiliation)
Bonne inspiration
TRANSCRIPTION
Salut à tous, c’est Jennifer Racine, blogueuse sur http://inspiremoidetavie.com et biographe familial.
Il y a quelques jours, j’ai eu la chance de rencontrer Halimata Fofana, auteur du livre « Mariama, l’écorchée vive ». Elle a accepté de me raconter son histoire, que je vous laisse découvrir dès maintenant.
Jennifer : Bonjour Halimata.
Halimata : Bonjour Jennifer.
Jennifer : Alors déjà, je te remercie d’être venue.
Halimata : Merci à toi pour l’invitation.
Jennifer : Ce n’est pas facile pour une première d’accepter comme ça, aussi facilement, alors merci beaucoup.
Je voudrais que tu me parles un peu de ton parcours. Pour commencer, j’aime bien parler « A l’état brut ». C’est à dire : comment tu es née ? Où tu es née ?
Halimata : Alors, je suis née à Longjumeau dans l’Essonne, dans le 91, pas très loin d’ici, en région parisienne. Alors, j’ai 35 ans, j’ai eu 35 ans le 13 janvier dernier. Je suis issue d’une famille de six enfants. Mes parents ont immigré du Sénégal vers la France dans les années 60-70. Et nous, la fratrie, nous sommes tous nés en France.
Alors, dans mon parcours, j’ai grandi dans une banlieue défavorisée, dans une cité, j’ai été dans des écoles, qu’on appelle ZEP.
Jennifer : Moi aussi.
Halimata : Voilà, on se retrouve là-dedans. Je pense qu’on est nombreux à avoir fréquenté des ZEP. Mais bon, comme quoi on peut s’en sortir, il n’y a pas de fatalité. J’ai été à l’école primaire, au collège, et après j’ai fait un lycée professionnel où j’ai fait un BEP hôtellerie restauration option cuisine, que je n’ai pas eu. Suite à cela, j’ai passé une année à travailler dans les médias en tant qu’assistante de production. Puis, j’ai rencontré quelqu’un qui travaillait pour la boite de prod d’Arthur. Je me souviens, il m’avait dit, Halimata reprends tes études, c’est mieux pour toi. Et je l’ai écouté, j’ai préparé l’équivalence du bac en lettre, le DAEU, Diplôme d’Accès aux Études Universitaires, c’était à Epinay Villetaneuse, que j’ai eu, que j’ai obtenu. Suite à cela, j’ai préparé un DEUG en art, puis une licence puis deux années de prépa en littérature et en histoire.
Jennifer : Courageuse.
Halimata : Quand on a envie, surtout quand on a la passion, on y va et suite à cela, j’ai travaillé dans les médias avant mon départ pour le Canada.
Jennifer : Beau parcours.
Halimata : Merci Jennifer.
Jennifer : Quand tu étais enfant, tu définirais comment ton caractère ?
Halimata:Ça dépend, avant ou après ?
Jennifer : Avant.
Halimata : OK, alors avant, j’étais quand même une petite fille assez docile, qui a envie de faire plaisir. Qui a surtout une envie d’être… Moi quand j’étais petite fille, je rêvais d’être fille unique. C’est ce que je voulais, je voulais être fille unique, je trouvais qu’il n’y avait rien de mieux que d’être fille unique. Alors ce n’était pas vraiment le cas puisqu’on était six, mais j’étais une petite fille qui rêvait beaucoup. Qui rêvait d’un avenir meilleur. Depuis petite, j’avais compris ça. Y a une scène même, dont je parle dans mon livre où je vais par la fenêtre et je regarde vers où habitait mon amie et je rêvais d’avoir ses parents, d’avoir son appartement, sa chambre, son lit, parce qu’elle était fille unique. Et j’enviais cela. Mais j’étais quand même assez docile. Très, très docile même. Gentille. Voilà.
Jennifer : Ça répond un peu à ma question, mais quels étaient tes rêves, tes grands rêves, du coup ?
Halimata : Quand j’étais petite, petite fille ?
Jennifer : Petite fille oui.
Halimata : Je voulais ressembler à tout le monde, je ne voulais pas me distinguer, je voulais être dans le moule. Tu vois ? Comme nous étions différents, comme mes parents viennent d’ailleurs, ils ont un accent… Et moi je ne voulais pas ça. Je voulais être la plus discrète possible. Et sinon, de quoi je rêvais d’autre ? C’était… C’est vraiment une bonne question parce qu’on m’a jamais posé cette question, c’est pour ça qu’il me faut du temps pour réfléchir. Surtout quand j’étais petite fille, je rêvais vraiment, c’est d’avoir une autre vie, que celle que je vivais. J’étais dans une espèce de projection. La vie que j’avais petite ne me convenait déjà pas.
Jennifer : Donc t’essayais de vivre par procuration en fait ?
Halimata : Voilà, beaucoup dans les livres, ou sinon en regardant beaucoup, en observant beaucoup les autres. Ça, ça m’a beaucoup, beaucoup aidé.
Jennifer : Très tôt.
Halimata : Très, très tôt ouais.
Jennifer : D’accord. Donc ta situation familiale. Qui sont tes parents ? Comment tu les définirais ?
Halimata : A l’heure actuelle ?
Jennifer : Tout au long du parcours.
Halimata : Bah ça a changé. Vous savez le regard change au fil du temps. A l’heure actuelle, je trouve que mes parents sont très courageux. Mes parents, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu’ils avaient. Je vous ai dit, mes parents sont arrivés en France dans les années 60-70, ils ne maîtrisaient pas la langue. Alors ils ne maîtrisaient ni la lecture, ni l’écriture. Alors c’est très, très dur quand vous arrivez, c’est un peu dans un autre monde, quand vous ne maîtrisez pas cela et vous ne maîtrisez pas les codes, ce n’est quand même pas facile. Alors ils ont eu six enfants, ils les ont élevé, on s’en est tous sorti, alors je leur tire mon chapeau. A l’heure actuelle, je suis en mesure de vous dire cela. Il y a dix ans, j’aurai sans doute tenu un autre discours. A l’époque, j’étais quand même, très, très rebelle. J’en voulais à me parents, j’en voulais à mes parents de ne pas être comme les autres, j’en voulais à mes parents de ne pas nous aider comme quand je voyais mes amis où les parents étaient très présents, d’un point de vue physique, ils étaient là pour leurs enfants, mais aussi d’un point de vue financier. Ça c’est quelque chose que je trouvais injuste, qu’ils avaient le droit à cela et pas moi. Alors que maintenant je sais qu’ils ont fait comme ils ont pu. Mais à l’époque, je voulais vraiment que mes parents, puisse nous aider concrètement et que sinon, c’était trop dur pour nous.
Jennifer : Et du coup, quelle éducation ils t’ont donné ?
Halimata : Alors mon éducation, nous avons eu une éducation Ouest Africaine. Pas l’ouest Africaine … De campagne ouest africaine, c’est plus juste. Nous sommes trois filles, trois garçons. Parce que nous étions des filles, nous avions des tâches qui nous incombaient. Parce que nous étions des filles, nous avions des devoirs et beaucoup moins de droits. Et quand on était un garçon, c’était l’inverse. C’est plus sympa d’être un garçon que d’être une fille. Il y avait des choses basiques qu’on ne pouvait pas, comme faire du sport. On ne pouvait pas faire de sport parce qu’on était des filles et les filles ce qui était important c’était de maintenir la maison. Nous, en tant que filles, on nous préparait à devenir des épouses et à être des mères. Alors très jeunes, on nous met ça dans la tête. On ne nous a pas laissé grandir. L’objectif, il faut grandir vite, vite, vite, vite, vite parce qu’il va falloir que tu saches tenir ta cuisine, il va falloir que tu saches tenir ta maison, alors il faut aller le plus vite possible. Alors c’était une enfance assez dure sur ce point de vue, là. Il y a aussi une enfance ou on éduque beaucoup avec la violence. Beaucoup, beaucoup avec la violence. Et ça, c’est très, très difficile. Où il y a qu’un seul chemin, et si vous ne prenez pas le chemin et bah ça peut vous coûter très cher. Mais il y a un seul et même chemin. Vous voyez ? Et c’est… Moi j’étais un peu rebelle, un peu beaucoup, alors je prenais un peu la tangente, mais ça me coûtait. Tu vois ?
Jennifer : Oui
Halimata : C’est dans ce sens, là. C’est à dire, une éducation stricte, très conservatrice, où on éduque les enfants avec beaucoup de violence et où on ne nous prépare pas à nous accomplir. Tu vois ?
Jennifer : Oui.
Halimata : On te dit pas : « bah vas-y, le plus important c’est que t’es un métier dans lequel t’es épanoui. » Non, non. Depuis petit on doit te dire, ce qui est le plus important, toi c’est que tu te maries et que tu ais des enfants. On va mettre ça dans la tête des filles.
Jennifer : Il n’y a pas d’enfance en fait. On est adulte directement.
Halimata : Oui, on n’a pas le temps. Et surtout quand c’est une fratrie où nous avons peu d’écart. L’objectif c’est que les grands grandissent pour pouvoir aider la maman. Tu vois ? C’est dans ce sens, là. Et on ne fait pas des enfants, l’objectif, ce n’est pas de… A l’heure actuelle, quand on fait un enfant, c’est qu’on décide d’avoir un enfant. On est dans un couple et on a envie de s’en occuper, on a envie de le choyer… Mais là, on fait des enfants parce qu’il faut faire des enfants. La réflexion ne va pas jusque, là. Tu vois ? On ne se pose pas la question « j’ai envie, j’ai pas envie », non.
Jennifer : « Comment on va l’éduquer ? »
Halimata : Non, non, non, non. Là on est loin
Jennifer : « Ce qu’on va lui apprendre ? Comment on va l’élever ? »
Halimata : Ah non là on est loin, loin, loin, loin, loin. On est loin de tout ça. Les enfants, ils arrivent, c’est comme si un peu, ils tombaient du ciel, tu vois. Voilà, ils arrivent, maintenant il faut s’en occuper. C’est ça. Ils sont là. C’est pour ça qu’on ne se pose pas de question. On se marie, et on se marie pourquoi ? Pour faire des enfants. C’est à dire que la sexualité féminine est uniquement reproductive. C’est rien d’autre. Tu vois ? Tu comprends le contexte ?
Jennifer : Oui, oui.
Halimata : Et c’est pour ça, qu’aux petites filles, même maintenant à des adultes, quand tu discutes un peu avec elles, elles vont te dire… Elles ne vont pas te dire « Bah ouais, j’ai envie d’avoir tel type d’emploi, j’aspire à ça ». Non, parce que c’est l’éducation, c’est là où on se rend compte de la force, c’est que, adulte on finit par croire ce qu’on nous a inculqué. On ne le remet pas vraiment en question.
Jennifer : Oui, c’est très dur de sortir de tout ça.
Halimata : Oui, c’est très dur de sortir de cela. Surtout qu’on n’a pas parlé d’un thème, je pense que tu vas aborder plus tard.
Jennifer : Oui
Halimata : Alors je te laisse l’aborder. Mais on est quand même dans un environnement où l’individu n’existe pas, où c’est le groupe qui prime sur l’individu. Raison pour laquelle on ne se marie pas pour soi mais pour consolider les liens familiaux. Ce qui veut dire que ce n’est pas toi qui va choisir ton mari.
Jennifer : Tu ne choisis pas ?
Halimata : Non, ça va être la famille qui va choisir untel parce que c’est bon pour la communauté. Que ce soit bon pour toi…
Jennifer : La communauté…
Halimata : Oui. Tu vois c’est penser de manière… Penser en groupe. Se penser en groupe et pas en tant qu’individu. Tu vois ? Et déjà petite, on te prépare à ça. Et petite on te fait croire qu’en tant qu’individu, tu n’existes pas et que ce qui prime, c’est le groupe. Mais quand tu grandi là-dedans, tu finis par le croire.
Jennifer : Forcément.
Halimata : Et c’est très, très dur de déconstruire ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend des années. Tu vois ?
Jennifer : Et tu retiens… Qu’est- ce qu’ils t’ont appris tes parents ? Qu’est-ce que tu retiens aujourd’hui ?
Halimata : La force de travail, ce que j’ai appris c’est la force de travail, le goût du travail bien fait, et, le plus important, même si c’est pour un euro, mais que tu l’ais gagné à la sueur de ton front. Ça, ce sont des valeurs que mes parents m’ont inculqué. Le courage aussi. Moi j’ai vu ma mère faire des ménages dans les écoles et ce n’est pas facile. Dans les écoles, dans les établissements scolaires, elle est même tombée. Ma mère, elle est très, très courageuse, moi je lui tire mon chapeau. Arrivée en France, elle s’est vraiment débrouillée, elle a pris aussi des cours alphabétisation. Elle s’est débrouillée, mais, il y a quand même la tradition qui reste. C’est ce que je dis souvent lors de mes conférences [Je vais pauser ça quand même
Jennifer : Tu peux le garder.
Halimata : Non, mais j’avais ça dans la main comme un micro, en train de parler]
Je dis souvent dans mes conférences, que les gens, quand ils arrivent en France, ils ne laissent pas leurs bagages culturels à l’aéroport. Les gens viennent avec. Et avec tout, tout.
Jennifer : Oui mais ça peut être une richesse aussi.
Halimata : Ca peut être. Oui, moi je pense qu’il y a les deux. Mais après le propre de l’adulte, c’est de savoir dissocier ce qui est bon et pas bon. Tu as raison, il y a des aspects positifs, comme ce que j’ai dit, le courage, la détermination, l’honnêteté, le sens de la parole.
Halimata : C’est aussi ça qui fait que les gens ne disent rien.
Jennifer : Oui, mais peut-être en parler en sein de la famille ?
Halimata : Non, ça non, c’est tabou.
Jennifer : Parce que c’est la sexualité en fait ?
Halimata : Oui, voilà, c’est lié au sexe de la femme. Vous savez, même d’autres… J’ai reçu de nombreux messages de femmes qui ont subi la même chose que moi. Le temps a passé, mais elles sont incapables d’en parler. Et de le dire aux vues et aux yeux de tous, « j’ai subi l’excision », les femmes n’en parlent pas, les femmes… C’est là que je montre… Ce qui est important de montrer c’est à quel point les non-dits sont forts dans cette question, là. Des femmes qui ont subi et qui sont maintenant… Qui travaillent, qui sont parfois mère de famille, elles vont refuser d’en parler.
Jennifer : Tellement la pression était forte dès le début en fait ?
Halimata : Et c’est resté. Elles ont totalement intégré le tabou lié à l’acte de l’excision. Elles l’ont tellement intégré qu’elles n’en parlent pas. Quand elles m’en parlent c’est via Facebook, ce qui n’engage à rien.
Jennifer : En privé
Halimata : Oui, voilà en privé, voilà c’est ça. Par message, elles me disent « oui, t’es courageuse », elles me disent des choses qui me touchent profondément. Elles me racontent aussi, parfois, ce qu’elles ont subi, les conséquences de l’excision, parce qu’il y a des conséquences importantes, les difficultés qu’elles peuvent avoir dans leurs vies de couple, avec leur conjoint, ça aussi c’est non négligeable. Le rapport qu’elles ont-elles même avec leurs propres filles. Parce que là aussi, il y a une projection. Même si elle-même, même si elles ne font pas cela à leurs propres filles, il y a quelque chose quand même de très ambiguë dans le rapport qu’elles ont avec leurs filles.
Jennifer : C’est à dire ?
Halimata : Bah, il y avait une femme qui m’avait fait cette confidence. Elle a subi l’excision et tout. Elle est plus du tout en contact avec ses parents, elle a fait ce choix, là. Et elle a une petite fille et elle n’est pas en mesure de donner de l’affection à sa fille. Elle peut lui donner… Elle va s’en occuper pour lui donner à manger, pour donner… Voilà, quelque chose d’assez primaire, mais ne serait-ce que de lui mettre la main dans les cheveux, pour elle, c’est une torture. Pour la mère c’est une torture, c’est pour vous montrer à quel point c’est lié à sa propre histoire, de la mère avec sa propre mère. Je pense qu’il faut qu’elle règle ça pour casser, pour éviter de répéter avec sa fille. Mais, c’est tellement fort, c’est tellement complexe, que… Elle a eu une fille, elle a voulu cet enfant, elle l’a désiré, malgré cela, il y a quelque chose qui reste.
Jennifer : Oui, c’est imprégné en fait.
Halimata : C’est ça, c’est pour ça que je dis que c’est une question de projection. Cette petite fille aussi, elle se voit à travers les yeux de sa petite fille. Parce qu’elle même m’avait fait cette confidence que sa mère n’était pas quelqu’un d’affectueux. Elle n’a pas connu les câlins, les bisous et pour elle c’est très dur. C’est très dur quand on n’a pas connu ça, de donner ça.
Jennifer : Oui de refaire… On refait tout le temps le même chemin.
Halimata : Oui, voilà c’est ça. Et c’est vrai que ça n’est pas évident, quand on n’ a pas connu l’affection, à son tour de donner, il faut vraiment aller chercher au fond de soi.
Jennifer : Un travail psychologique qui prend des années.
Halimata : C’est un travail à faire. Il faut le faire, parce qu’il ne faut pas que la fille devienne aussi… On ne peut pas répéter ad vitam æternam, ce que les mères et grand-mères ont reproduit.
Jennifer : Surtout quand on a souffert nous-même.
Halimata : Voilà, mais vous savez, nous sommes nombreux sur cette Terre… C’est Annie Smile qui parle du schéma de répétition. Mais quelque chose de basique : la fessée. Les parents mettent une fessée à un gamin ou une claque. Vous allez dire aux parents « mais pourquoi tu donnes une claque ? ». Il dit « Oh bah moi j’en ai reçu, je ne m’en porte pas plu mal ».Ou, il va vous dire « c’est pour son bien ». Je trouve ça assez contradictoire de parler du bien et de violence. On peut se poser la question.
Jennifer : C’est vrai.
Halimata : Et cet adulte dit que, lui a reçu des claques et qu’il ne s’en porte pas plus mal. Il est dans un schéma de répétition. Il a reçu des claques et il donne des claques à son tour. Et qu’est-ce qui fait que… Elle l’explique très bien Annie Smile… on va s’arrêter et on va faire autrement ? C’est quand, étant adulte, on est capable de se dire que nos parents se sont trompés. De se dire, de remettre en cause nos propres parents, et de nombreux adultes ne le font pas. Parce qu’il y a une sacralisation des parents, il y a, voilà, « mes parents sont merveilleux ».
Mais pour le bien de soi et pour la génération suivante, c’est aussi bien de reconnaître qu’ils se sont peut-être trompés là. Ils ont fait comme ils ont pu certes, mais là ils ont peut-être mal fait. Et à partir du moment où vous êtes en mesure de faire ça c’est que vous êtes en mesure de remettre en cause vos propres parents et donc de remettre en cause leur action.
Jennifer : Et peut-être de se remettre en cause soi-même après.
Halimata : Oui et donc c’est là… Comme vous réfléchissez et vous essayez de voir autrement, de voir les choses de manière différente, vous allez donc ouvrir une autre porte qui va être différente de celle de vos parents et vous serez beaucoup moins dans un schéma de répétition parce que vous verrez… Souvent les petits garçons qui ont connu la violence ils vont battre à leur tour. Là aussi c’est un schéma de répétition. Qu’est-ce qui fait qu’il y a certains qui vont répéter et d’autres qui vont casser ce schéma? C’est la remise en cause ses parents, de ce qu’on a vécu et de reconnaissance, de reconnaissance de sa souffrance : « bah oui quand j’ai pris une claque ça m’a pas fait du bien ». Il faut reconnaître. Si vous reconnaissez qu’avoir pris une claque ça ne vous a pas fait du bien, sans doute, vous allez moins mettre de claque à votre tour.
Jennifer : C’est sûr. Et du coup, le parcours après ça, après la blessure
Halimata : Alors après la blessure de l’excision…
Jennifer : Dans la continuité de la blessure du coup.
Halimata : Je rentre en France. J’étais à l’école maternelle. Et là, moi je pose aussi cette question, là : une petite fille que vous voyez marcher là, mais d’une manière où vous voyez qu’il y a quelque chose. Alors on ne pose pas de question. Moi je pose cette question, là. Une petite fille que vous voyez marcher un peu les jambes écartées, les jambes arquées, et y a pas un adulte qui se baisse pour savoir, pour demander ce qui se passe.
Jennifer : C’est plus facile de fermer les yeux en général.
Halimata : C’est ça. On ferme les yeux et on se rend complice, attention, on se rend complice. Alors même si la petite fille que j’étais ne connaissait pas le mot excision, j’aurais pu dire « oui j’ai mal, j’ai un bobo, on m’a fait ça » avec des mots d’enfant.
Jennifer : Encore aurait-il fallu poser la question.
Halimata : Exactement, exactement, tu as tout dit Jennifer, mais on n’a pas voulu voir. Le PMI, le centre de protection maternelle infantile de la ville où je résidais, avant que je parte, il m’a ausculté. Il a vu que j’étais entière. Et après il a vu qu’il y avait quelque chose qui avait changé. Il n’a rien dit.
Jennifer : Il n’a rien fait.
Halimata : Il n’a même pas fait de cinéma rien du tout. Rien, rien, rien, rien. Et là aussi on peut parler de complicité de la part de ce médecin. Et vous savez pourquoi même ça a reculé au niveau des petites filles qui ont été excisées. C’est toute une campagne qui a été faite par une avocate, Linda Weil-Curiel, qui s’est battue pour que l’excision soit jugée comme un crime et non comme un délit. Parce que voler quelque chose, ça n’a rien à voir avec arriver et amputer, c’est quand même criminel. Elle explique parfaitement bien que… il y a eu des formations au niveau des médecins et des pédiatres, et c’était clairement indiqué que si la maman dit qu’elle va… Qu’elle part en vacances en Afrique avec sa petite fille, le pédiatre doit ausculter la petite et il dit aux parents : « j’ai vu votre fille, elle est complète. Si vous partez et qu’elle revient et qu’elle n’est pas dans l’état dans lequel je l’ai vu, on va faire un signalement et vous aurez à faire à la justice ». Les familles ont eu peur. Ce n’est pas qu’ils ont compris. Ils ont eu peur. Disons la vérité, c’est la peur d’aller en prison.
Jennifer : C’est déjà un premier pas.
Halimata : Oui voilà exactement, c’est un premier pas. Et ça a sauvé de nombreuses petites filles, cette menace de se dire « on va allez… vous allez aller en prison ». Et dans les années 80, c’est une petite fille qui s’appelait Bobo. Le père savait que c’était interdit d’exciser sa fille en France. Le père le savait pertinemment. Alors, la petite, je crois qu’elle a… quatre mois… entre trois et cinq mois. Le papa fait venir une dame exciseuse, ils excisent la petite, le bébé. Le bébé saigne, et saigne abondamment. Mais le père se dit « bah je ne peux pas aller à l’hôpital ». Si il va à l’hôpital, on va lui dire « bah attendez, qu’est-ce qu’il s’est passé avec votre fille ». Le papa décide de ne pas aller à l’hôpital et de rester chez lui alors que la petite se vide de son sang. En fin de journée, il se dit « bah tient, je vais peut-être aller à l’hôpital ». Il arrive à l’hôpital, c’est trop tard, la petite est morte. Elle est morte d’hémorragie. La petite s’est vidée de son sang. Mais c’est là où on se rend compte que c’est quand même incroyable. Et là, à ce moment, là, le chef d’inculpation, pour les parents, vous savez ce que c’était ? « Non- assistance à personne en danger ». C’est des cacahuètes ça.
Jennifer : Un petit peu.
Halimata : Alors que c’est criminel. C’est eux qui ont tué leur fille. Certes, c’est la dame qui a été couper la petite. Mais qui est-ce qui a fait venir cette dame ? Ce sont les parents. Sinon jamais elle serait venue.
Jennifer : C’est rare qu’on sonne à la porte comme ça.
Halimata : Ouais, voilà, c’est ça. C’est rare qu’on sonne à la porte comme ça « coucou c’est moi, je suis exciseuse.
Jennifer : C’est rare.
Halimata : Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais, c’est pour que les… Parce que parfois ils disent « oh mais non, il faut juger l’exciseuse et pas les parents ». Non. Les parents sont tout autant responsables parce que c’est eux qui apportent leur fille. C’est eux qui prennent leur fille et qui l’amène chez cette femme. Ils sont, pour moi, c’est égalité. Si c’était moi, je mettrai les mêmes peines pour les familles et pour l’exciseuse.
Alors, je reviens à moi. Suite à cela je vous ai dit je suis revenue en France, je me suis mise à faire pipi au lit alors que je ne faisais pas avant d’avoir été excisée mais on n’avait pas fait le rapprochement entre les deux dans ma famille. Moi je l’ai su après coup, en allant voir le chirurgien qui m’a réparé. Nous avons discuté et c’est lui qui m’a appris qu’il y a un lien direct entre l’excision et le fait que je me suis mise à faire pipi au lit. Moi ça a été cela, mais à d’autres femmes ça va être autre chose voyez-vous. Moi je connais des femmes qui après avoir subi l’excision avaient des douleurs constantes au niveau du vagin. Tout le temps, elles avaient mal. Des années et des années, elles avaient mal. Jusqu’à ce qu’elles se fassent opérer par le chirurgien et suite à cela, la douleur s’est arrêtée nette. Vous voyez. Et après je pense qu’il y a… Moi pendant très, très longtemps j’ai eu un dégoût de mon propre corps. J’ai eu un dégoût parce qu’il y avait un étranger qui a osé mettre sa main dans ce que j’avais de plus intime en moi et je trouvais que par cet acte, là, le corps que je portais ne m’appartenait pas. Il était à eux.
Jennifer : Alors que t’y es pour rien finalement.
Halimata : Mais c’est ça le problème. C’est qu’on n’y est pour rien mais on a honte. C’est comme les femmes qui se font violer. Elles y sont pour rien mais tu vois, elles ont honte de ce qu’elles ont subi alors qu’elles sont victimes. C’est ça c’était vraiment très, très dur cette espèce de dégoût de soi, c’est compliqué à gérer
Jennifer : Finalement c’est peut-être ça le plus dur en fait ?
Halimata : Oui c’est sûr parce qu’après il faut apprendre à s’aimer et ça c’est une autre paire de manches. Et alors ce que je faisais c’est que je m’étais dans ma tête… J’avais dissocié mon corps, mon corps et ma tête. Je les avais dissociés. Pour moi mon corps, ce n’était pas moi.
Le regarder… J’ai essayé de faire un travail pour me réconcilier moi-même avec moi-même. Vous voyez ? Me réconcilier avec mon histoire et surtout d’accepter ce qui m’était arrivé et de pardonner. Tu vois ?
Jennifer : Long travail
Halimata : Ouais c’est ça. Bah ça prend des années. Je te le dis franchement, ça prend des années.
Jennifer : Et justement quand t’es parti au Canada du coup. Qu’est-ce qu’il en ressort ? Qu’est-ce que tu as vécu là-bas ?
Halimata : Au Canada, c’était une très belle expérience puisque j’y ai vécu cinq ans. Alors je tente de voir le pays, de comprendre un peu le fonctionnement. Le Canada, ça m’a permis vraiment de faire le point. De me retirer vraiment de l’environnement dans lequel j’ai évolué pour voir autrement. Quand vous êtes dans un environnement vous avez tendance à voir toujours de la même manière. Et là, le fait que je sois loin, ça m’a permis… J’ai eu cette chance là parce qu’il y a des gens ou ça fonctionne pas, vous pouvez les amener peu importe où, ils gardent ça. Mais moi, j’ai eu cette chance de rencontrer des gens qui m’ont permis de voir les choses de manière différente. Je n’étais pas fermée à ça, au contraire je voulais apprendre. J’étais dans une espèce de quête pour… Je voulais apprendre à m’aimer, je voulais apprendre à accepter mon histoire, je voulais apprendre à être la vraie Halimata. Et pas celle qui est victime. Je voulais dépasser mon statut de victime, de ce que j’avais subi et je ne voulais surtout pas qu’on me définisse comme victime de l’excision. Je voulais aussi… Parce que, pendant très longtemps, pour moi, je n’étais pas une femme, avant de partir. Comme j’avais subi ça. Malgré la réparation que j’avais faite, pour moi je n’étais toujours pas une femme à part entière. Et là-bas j’ai appris aussi ça. A m’accepter telle que je suis et à me dire « Bah je suis une femme malgré tout. Et que tout est possible. Ça, c’est ce que j’ai appris en Amérique du Nord. Tout est possible. La porte est ouverte quoi. C’est pour ça que je me suis mise à écrire. Là-bas j’ai cru que c’était possible, que je pouvais me mettre à écrire, que mon livre puisse être publié. Là-bas, oui je pense que si j’étais restée en France… Si j’étais restée en France non, j’aurais pensé « bah ce n’est pas pour moi ça. Ça c’est pour les autres mais pas pour moi ».
Jennifer : Quelle est la différence, en fait, entre les deux mentalités, les deux cultures ?
Halimata : En Amérique du Nord, c’est une société qui est très optimiste. C’est une société aussi qui est très portée sur l’entrepreneuriat. Et quand vous dites « oui j’ai envie de faire ceci ou de faire cela », les gens ne vont pas vous dire « ah bah non ». En France, c’est horrible, tu dis que tu veux faire ça, on va te dire « oh bah non, je ne sais pas quoi ».
Jennifer : Dès tout petit en général.
Halimata : Oui c’est terrible alors que là-bas, on va vous dire « bah vas-y go, vas-y essaye et si tu n’y arrives pas ce n’est pas grave. Au moins tu auras essayé ». Et vous savez même du côté des États-Unis ont fait plus confiance à un entrepreneur qui a eu des échecs qu’à un entrepreneur qui réussit du premier coup parce que l’échec ça forge et ça montre que c’est quelqu’un qui est capable de revenir malgré les échecs. Une fois, deux fois, trois fois il ne lâche pas. Il a la niaque.
Jennifer : Détermination en fait.
Halimata : Et c’est ça détermination à fond. Mais si vous avez réussi dès le premier coup…
Jennifer : Ça peut paraître une part de chance.
Halimata : Ça peut être une part de chance. Mais on ne sait pas, ça révèle pas votre caractère parce que c’est vraiment dans les difficultés que les gens se révèlent réellement. Parce que là, ils ne font plus semblant. Mais vraiment pour moi ça a été une expérience très enrichissante. D’ouverture sur le monde aussi. D’accepter les autres tels qu’ils sont, de ne pas être dans le jugement. Ça, j’ai appris ça, là-bas. Qu’on peut être différent aussi. J’ai appris ça. Qu’on peut avoir des chemins de vies complètement différents. Et ce n’est pas parce que c’est différent que c’est mauvais ou pas bien. C’est juste différent. Ça, j’ai appris ça aussi là-bas. J’ai beaucoup appris là-bas.
Jennifer : Plus qu’en France finalement pendant toutes ces années.
Halimata : Bah ce n’était pas du tout la même dynamique. Là-bas vraiment j’avais pris le temps… Bah déjà j’étais malade, je ne pouvais pas travailler. Alors j’ai arrêté de travailler. Et donc j’ai fait un travail sur moi très profond. J’avais commencé à le faire en France mais comme j’étais toujours dans cette dynamique de combat c’est très compliqué pour… Là, là-bas, j’ai lâché prise. Je me souviens, j’avais quitté mon appartement, j’étais partie en collocation, j’étais très tranquille. C’est à dire que les soucis du quotidien, il fallait que j’en ai le moins possible. Voilà. Et c’est là que j’ai pu me regarder. Mais quand vous êtes dans l’urgence… Mais vous n’avez pas le temps de faire ça.
Jennifer : C’est vraiment de vivre l’instant présent et être face à soi.
Halimata : Oui voilà. Exactement, apprendre à vivre dans l’instant présent c’est quelque chose que je ne savais pas faire. Moi, j’étais tout le temps dans la projection. Jamais dans l’instant. J’ai appris ça là-bas aussi
Jennifer : C’est peut-être aussi lié à l’Île-de-France qui est un peu… Très…
Halimata : Mais je pense que tu as sans doute raison parce que même depuis que je suis rentrée, là, ça fait un an que je suis rentrée, je trouve ça dur d’être en Île-de-France. Je trouve… Tu sais les gens sont très pressés. Vraiment très, très pressés. Vraiment pressés mais tout le temps. Tu ne sais pas pourquoi, où est-ce qu’ils vont, mais ils sont toujours très pressés. Je trouve que l’atmosphère, je trouve qu’elle est… Ce n’est pas très… Je trouve ça lourd. Et plus le temps passe et plus je trouve ça lourd l’atmosphère. Alors bon, je vais peut-être m’exiler ailleurs en France. Je ne crois pas que j’irai sur un autre continent. A l’heure actuelle non, je ne crois pas. Mais j’ai envie d’être dans un endroit plus paisible parce que ce que je cherche à l’heure actuelle, c’est que ce soit en adéquation avec l’état d’esprit dans lequel je suis. Tu vois ? Moi je ne suis pas dans une course effrénée. Je ne suis pas du tout là-dedans. Tu sais, je ne suis pas prête à me tuer pour louper le métro alors que deux minutes après il y a un autre métro quoi, tu vois. Tu vois, ça j’ai remarqué ça, tu vois à Rennes… Quand j’étais à Rennes il y avait le métro et ma copine, elle me dit « bah, on prendra le prochain ». Je lui ai dit « Ah ça c’est rigolo, ça serait à Paris on aurait couru alors que deux minutes après, il y en a un.
Jennifer : Alors qu’on est la région la plus desservie normalement.
Halimata : Ouais c’est ça.
Jennifer : C’est important deux minutes.
Halimata : C’est ça, c’est là qu’on se rend compte que deux minutes c’est quand même deux minutes alors il faut quand même les prendre. Et tout compte fait même avec ces deux minutes là, on ne s’en sort pas réellement pour nous parce qu’on court tout le temps, qu’on passe son temps à courir et prendre le temps vraiment d’être tranquille, d’être posée, ça fait vraiment énormément de bien. Et même au niveau de la qualité de vie ça change aussi je pense.
Jennifer : Donc justement après la blessure il y a la reconstruction et comment tu as fait ?
Halimata : A l’époque j’étais encore étudiante. J’avais entendu parler de cette reconstruction par le G.A.M.S qui est l’association qui lutte contre les mutilations génitales faites aux femmes. Je m’y suis rendue, je me suis assise. J’ai entendu une fille demander un numéro, le Docteur Pierre Foldes. J’ai demandé le numéro et je suis partie. Et je n’y suis plus jamais revenue. Et j’appelle. Alors j’obtiens un rendez-vous avec le Docteur Foldes je vais dans sa clinique à Saint-Germain-En-Laye. Il regarde. Il regarde pour voir si je suis opérable parce que toutes les femmes ne sont pas opérables. Tout dépend de la manière dont c’est fait. Il y a des femmes, ce n’est pas possible. Et il me dit « bah oui toi tu es opérable… Vous êtes opérable ». Il prend rendez-vous avec l’anesthésiste, des choses comme pour une opération lambda. Et après le jour de l’opération. Que je n’ai pas dit. Mais je l’ai fait en cachette.
Jennifer : Encore une fois.
Halimata : Je me souviens j’étais à la fac. Alors ça se fait très rapidement, très facilement. « En quarante minutes hop, hop, hop ». C’est vrai c’est hop, hop, hop, pour lui mais pour nous ce n’est pas hop, hop, hop. Et suite à l’opération… Bah là, je me souviens j’avais passé la nuit là-bas. Le Docteur Foldes, il m’avait dit « surtout ne restez pas debout. Si vous restez debout ça gonfle et ça va vous faire mal ». Sauf que comme moi j’avais menti, il fallait que je continue ma vie d’étudiante. Et je me souviens, j’étais à Paris III et je crois que c’est le lendemain ou deux jours après, il fallait que j’aille à la fac. J’avais tellement mal, j’en pleurais sur la route. J’en pleurais tellement la douleur était forte. Vous imaginez ? Parce que c’est très… C’est dans des endroits très sensibles. Alors quand ça se réveillait terrible, terrible, terrible, terrible, terrible. Il m’avait prévenu hein, mais bon c’était moi, il fallait que je fasse comme si de rien n’était. Alors après cette opération, je me suis rendue compte que ce n’était pas magique. Oui, mais faut le dire aux femmes. C’est pas magique, ce n’est pas hop, hop, hop et hop, non. Le gros travail c’est psychologique
Jennifer : Ça ne dure pas quarante minutes.
Halimata : Ouais voilà non. Le gros travail c’est psychologique. Parce que même après le travail, c’est un travail de réappropriation de son corps. Vous devez apprendre à vous connaître, vous devez vous observer, vous devez aimer aussi ce corps. Parce que là, l’excision, il y a une personne étrangère qui va dans ce qui a de plus intime en vous. Et là, avec la chirurgie, il y a une autre personne qui vient. On va dire, certes elle vient réparer, mais c’est quand même quelqu’un d’autre qui vient encore dans ce qu’il y a de plus intime en vous. C’est-à-dire que ce n’est pas évident ce n’est pas une opération comme ça lambda. Alors moi j’ai eu un très, très long travail thérapeutique pour me réapproprier mon corps, pour accepter ce qui m’était arrivée et pour aussi comprendre que l’opération ce n’était pas magique. Et que le gros du travail c’est à moi-même de le faire. Et qu’il y a personne qui va pouvoir le faire à ma place. Peu importe le chirurgien, peu importe le psychologue. Peu importe. C’est moi qui vais devoir faire ce travail, là, si je veux être en paix avec moi-même.
Jennifer : Donc déjà le travail de se dire que c’est quelqu’un qui nous a mutilé et qu’il faut soi-même tout réparer en fait, tout reconstruire. Et finalement peut-être enlever cette rancœur pour avancer.
Halimata : C’est ça. Enlever cette rancœur, parfois même cette haine qu’on peut avoir. Et de se dire… Parce que c’est particulier… Parce que l’excision, elle est faite, quand même par des gens de votre propre famille. C’est ça qui est difficile. C’est compliqué quand même à gérer. De se dire « bah attends, cette femme qui dit m’aimer, elle m’a quand même fait subir ça ».
Jennifer : Donc il y a un manque de confiance, en plus, après. On est seule en fait.
Halimata : Bah on est totalement seule. Et là en tout cas, vous savez qu’il y a quelque chose qui s’est brisé. Parce que là, vous vous dites quand même que la mère qui est censée protéger sa fille, bah elle l’a pas fait. Elle ne l’a pas fait. Et donc, bon, il faut trouver un autre… Il faut trouver un autre moyen de… Pour la protection. Vous comprenez que c’est à vous même de vous protéger. Moi c’est ce que j’ai compris. Qu’il n’y a personne qui pourra me protéger. C’est à moi de le faire. Sinon, il y a personne de ce monde qui le fera. J’ai une amie qui me dit « Halimata, tu te trompes » Elle me dit « bah non » parce qu’avec son conjoint, il la protège et tout. Il a toujours été là et tout. D’accord. Mais moi, c’est ce que je me disais. Qu’il y a personne qui pourra me protéger. Après ça dépend de l’histoire de chacun. Y a pas de règle établie « oui c’est lui, ceci, cela, non. Moi, à mon époque… A ce moment-là, pardon… il n’y avait personne qui pouvait me protéger. Et ça, je l’ai compris très tôt.
Halimata : Je l’ai écrit, ça devient public. Il va de soi qu’il y en a certains qui ne vont pas être, forcément, en adéquation avec ce que j’écris. Mais il y en a d’autres que ça aide. Et pas forcément que des femmes qui ont subi la même chose que moi. Parce que nous subissons tous des épreuves. Elles sont diverses d’une femme à une autre ou d’un individu à un autre. Mais on se retrouve aussi dans la manière dont je décris la douleur. Dans le ressenti. Et je trouve que c’est ça qui est intéressant. Y a même un homme qui m’a fait des confidences en me disant « Bah oui, Halimata, ce que tu as écris, je me suis retrouvé dedans ». J’ai trouvé ça très beau.
Jennifer : C’est universel après.
Halimata : Oui. Je tends vers… Vers l’universalisme.
Jennifer : Et de quoi tu es la plus fière, en fait, dans ton parcours, du coup, après tout ça ?
Halimata : De quoi suis-je la plus fière ? Alors… D’avoir surmonté tout cela. D’être face à toi aujourd’hui et de pouvoir parler de sujets qui sont très, très forts. Vraiment, le numéro un, je dirais, d’avoir surmonté tout cela. Le plus beau compliment qu’on m’ait fait, c’est la conjointe d’une amie qui m’a dit « Halimata, tu es une Warrior ». Pour moi c’était le plus beau compliment qu’on puisse me faire. C’est ça. Malgré tout, j’ai foncé alors que ce n’était pas évident, ce n’était pas facile. Mais j’y suis quand même arrivé.
Jennifer : Donc le jeu en vaut la chandelle finalement.
Halimata: Oui, le jeu en vaut la chandelle.
Jennifer : Même si on est très bas, on peut se relever.
Halimata : Oui je suis convaincue qu’on peut se relever de tout. J’en suis convaincue. De tout. Après, il faut avoir la volonté, il faut avoir envie. Après ça dépend de soi. Mais on peut. Je vous ai dit tout à l’heure « tout est possible ». Dans ce monde tout est possible. Encore faudrait-il y croire. Si vous croyez, tout est possible. Mais si vous n’y croyez pas, non ça ne va pas être possible. C’est déjà ça. Quand vous y croyez, hop, vous avez déjà l’esprit qui va vers. Moi, ça, j’en suis convaincue.
Jennifer : Et du coup quels sont tes projets maintenant ?
Halimata : Alors mes projets… J’ai terminé l’écriture de mon deuxième livre. Je souhaite qu’il paraisse en 2017. Alors je continue à animer des conférences partout en France et je souhaite travailler dans les médias. Avoir une chronique consacrée à la culture, à la littérature. C’est ce que je souhaite faire et je travaille pour. Et je souhaite aussi rencontrer toutes ces femmes… Parce que j’interviens aussi dans les établissements scolaires. Essayer de faire changer l’état d’esprit, de se dire que c’est possible quoi. Même si c’est dur, c’est quand même possible. Il n’y a pas de fatalité. Et que les femmes comprennent que même si on a subi des choses atroces, on ne se résume pas à ce que l’on a subi. On est beaucoup plus forte que cela. Mais il faut sortir de son statut de victime. On n’est pas que victime de quelque chose. On n’est pas qu’une femme excisée ou une femme autre chose. On est une femme avant tout.
Jennifer : Avec pleins de facettes différentes.
Halimata : Exactement. Nous avons toutes des facettes différentes. Voilà, il faut les mettre en lumière. C’est ça tout le parcours, ce que l’on doit faire, c’est mettre en lumière nos compétences, nos capacités, nos belles réalisations, je trouve.
Jennifer : Ce n’est pas facile tout ça.
Halimata : Ce n’est pas facile, mais c’est possible
Jennifer : C’est possible tu en es la preuve vivante d’ailleurs.
Halimata : Bah ça, je ne sais pas si j’en suis la preuve vivante. Mais en tout cas j’y crois.
Jennifer : Bah je te remercie beaucoup en tout cas.
Halimata : Merci à toi.
Jennifer : Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Halimata : Bah j’invite…
Jennifer : J’attendais
Halimata: Alors j’invite tous les auditeurs à lire mon livre « Mariama l’écorchée vive » aux éditions Karthala. Alors, vous pouvez le commander partout, dans les librairies ou sur Internet. « Mariama l’écorchée vive ». Merci.
Jennifer : Je mettrai un petit lien en-dessous de la vidéo.
Halimata : OK merci.
Jennifer : Merci beaucoup, en tout cas, d’avoir accepté. Surtout pour la première.
Halimata : Bah je suis vraiment ravie d’avoir échangé avec toi sur ces questions. Merci à toi.
Jennifer : Merci beaucoup.
Halimata : Je reviendrai pour le deuxième.
Jennifer : Avec plaisir.
Halimata : OK.